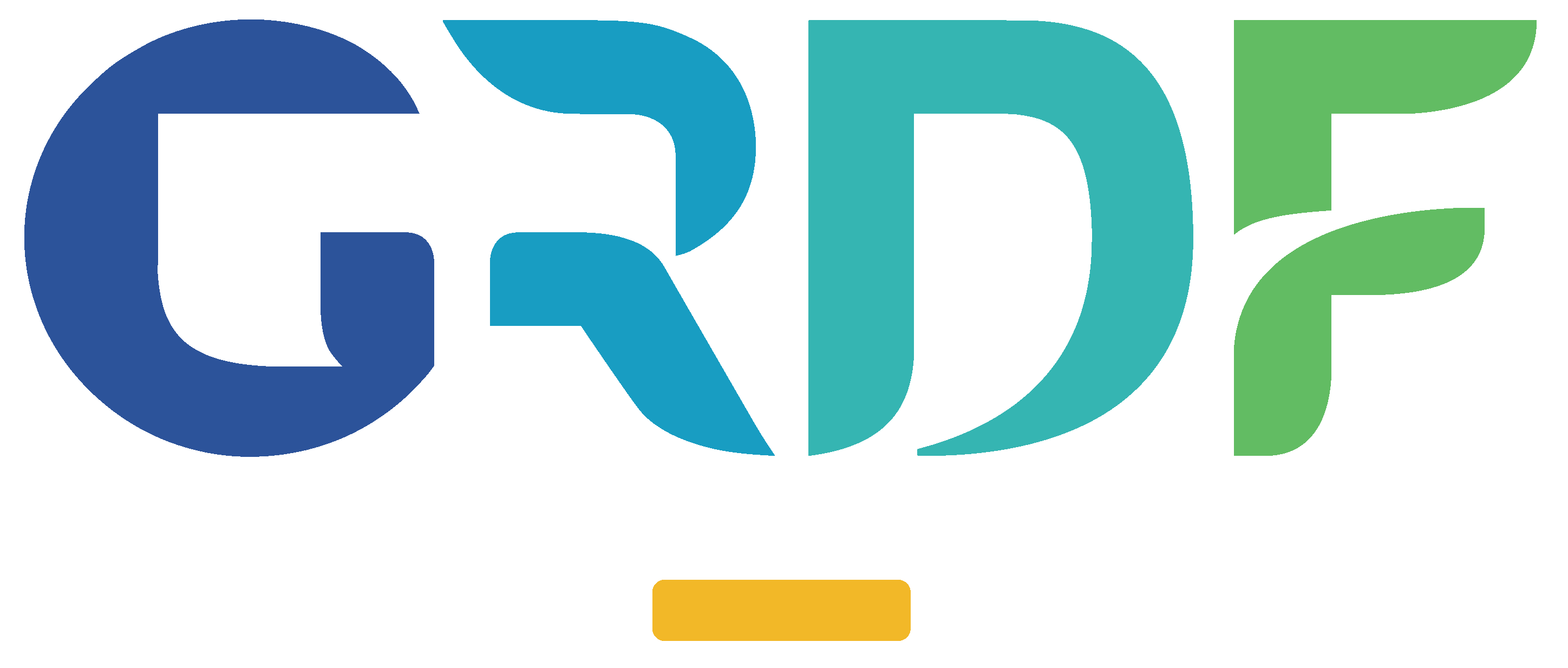Le texte sur les exemptions de droits de douane sur les produits américains sera prochainement soumis au vote du Parlement européen. Dans un contexte géopolitique instable, les droits de douane apparaissent comme une arme stratégique pour les États qui souhaitent asseoir leur puissance commerciale et énergétique.
Longtemps considérés comme de simples outils économiques, les droits de douane ont pris une dimension géopolitique inédite depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, aux États-Unis. Alors qu’ils s’établissaient en moyenne à 5 % pour l’ensemble des partenaires commerciaux américains, ils ont récemment connu une escalade tarifaire sans précédent. L’ensemble des pays et des produits pouvant être touchés par ces menaces, la dépendance énergétique de la France et de l’Europe aux énergies fossiles d’autres grandes puissances soulève de véritables questions. Comment se protéger des effets d’une guerre commerciale ? Pourquoi faut-il favoriser la souveraineté énergétique française et européenne face aux menaces étrangères ? Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce à l'Institut de recherche européen Jacques-Delors et rapporteur du groupe de travail sur les relations UE-Chine, et Phuc Vinh Nguyen, chercheur sur la politique française et européenne de l'énergie et chef du Centre énergie de l'Institut Jacques-Delors, ont accepté de décrypter avec nous cette dynamique qui bouleverse le marché de l'énergie.
Les droits de douane, nouvelle arme géopolitique
« Une arme stratégique, oui, mais c’est surtout l'outil préféré de Donald Trump ! » affirme Elvire Fabry. Les menaces d’utilisation faites ces derniers mois par le président américain de ces barrières tarifaires dépassent largement le cadre économique traditionnel. « Nous ne sommes pas du tout dans un exercice de réajustement de la balance commerciale, mais véritablement dans un exercice de coercition économique », ajoute-t-elle.
Les droits de douane se sont ainsi transformés en instruments de pression politique, touchant même aux garanties de sécurité. L'exemple le plus frappant concerne les menaces tarifaires conditionnées à des réformes réglementaires. La position du vice-président américain J.D. Vance en est l’exemple parfait : « Il affirmait que si l’Europe voulait bénéficier des garanties de sécurité américaines et du soutien des États-Unis à l'Ukraine, il allait falloir revoir les réglementations autour du numérique en lien avec l'application des droits de douane », rappelle Elvire Fabry.
En d'autres termes, Washington lie désormais le soutien militaire à l'Europe à des concessions commerciales : pour éviter les droits de douane et conserver la protection américaine, l'Europe devrait assouplir ses réglementations sur les géants du numérique. Ces menaces placent l’Europe et la France dans une situation d’insécurité grandissante.

Crédits : Elvire Fabry
La redistribution des flux énergétiques
Cette utilisation stratégique des droits de douane provoque une redistribution massive des flux énergétiques mondiaux. Les tensions commerciales sino-américaines illustrent parfaitement ce phénomène. Après une escalade spectaculaire comprenant des menaces évoquant des taux allant de 125 à 145 %, les négociations ont finalement abouti à une stabilisation relative. « Les droits de douane se sont finalement établis à 10 % côté chinois et 30 % pour les exportations chinoises aux États-Unis, qui s'ajoutent aux 20 % existants, explique Elvire Fabry. Des droits de douane sur les biens chinois qui s’élèvent donc à 50 %, ce qui est colossal ».
Le cas du gaz naturel liquéfié (GNL) illustre également ces changements : « À l’heure où nous parlons, la Chine n'a pas importé de GNL américain depuis février 2025, observe Phuc Vinh Nguyen, chef du Centre énergie de l'Institut Jacques-Delors, une dynamique qui va s’avérer plutôt bénéfique pour les Européens qui apparaissent comme une porte de sortie pour attirer ce GNL américain ».
L'Europe face à de nouvelles vulnérabilités
Fin juillet 2025, la présidente de la Commission européenne et le président américain sont parvenus à un accord de principe dont la principale mesure est un engagement des Etats-Unis à appliquer à leurs importations originaires de l'Union européenne un droit de douane unique de 15 %, en lieu et place d'un droit de douane 30 % qui devait entrer en vigueur au 1er août.
L'Union européenne s'est également engagée à acheter 750 milliards de dollars d'énergie (gaz naturel, combustibles nucléaires et pétrole) sur trois ans et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis. Cela permettrait notamment de remplacer les importations de gaz russe par du GNL américain.
Dans un courrier envoyé le 15 septembre, vingt-huit eurodéputés ont interpellé la Commission européenne au sujet des promesses d’achat d’énergie pour 750 milliards d’euros faites à Donald Trump. Selon les signataires, ce plan « nuit directement à nos ambitions climatiques » et pourrait mettre en péril les trajectoires ambitieuses de l’Europe en termes de transition énergétique.
L'Union européenne se trouve dans une position particulièrement délicate. D'un côté, « elle bénéficie de la stabilité réglementaire que recherchent les investisseurs », souligne Phuc Vinh Nguyen.

Crédits : Phuc Vinh Nguyen
Mais paradoxalement, l'Europe présente, de l’autre côté, une dépendance énergétique : « Le gaz naturel liquéfié américain représente la moitié de nos importations de gaz naturel liquéfié, précise Phuc Vinh Nguyen. Une tendance qui a vocation à s'accroître, car les Américains cette année pourraient devenir les deuxièmes exportateurs de gaz au niveau européen, derrière la Norvège ».
Cette dépendance présente des risques géopolitiques majeurs. Contrairement aux contrats d'approvisionnement traditionnels, les exportations américaines de GNL peuvent être suspendues du jour au lendemain sur décision unilatérale de Donald Trump : « Une simple raison qu’il jugerait impérieuse lui suffirait juridiquement à justifier un embargo par exemple, si les prix du gaz s'envolent sur le marché américain, explique le chercheur, Washington pourrait alors décider de conserver son gaz pour sa consommation intérieure ».
Le biométhane renforce la souveraineté énergétique à l’ère des tensions géopolitiques
Dans ce contexte de guerre commerciale et d'instabilité des approvisionnements énergétiques, l'Europe mise sur le développement des gaz renouvelables, comme l’illustre le lancement du partenariat avec l’European Biogas Association dès 2023. « Les objectifs sur le biométhane représentent 35 milliards de mètres cubes (bcm) à l'horizon 2030 », indique Phuc Vinh Nguyen. Cette stratégie présente un avantage géopolitique majeur : contrairement aux importations de GNL soumises aux aléas des droits de douane et des décisions politiques, le biométhane produit localement échappe aux pressions tarifaires internationales.
Le biométhane présente de nombreux avantages comme sa complémentarité avec les activités agricoles. Les exploitants peuvent valoriser leurs résidus de cultures, fumier et autres déchets organiques pour produire du gaz vert, créant ainsi une source complémentaire de revenus, sans modifier leur activité première de production alimentaire par exemple. Les producteurs de biométhane par méthanisation produit également des engrais naturels qui se substituent aux engrais chimiques.
L'impact des droits de douane sur la transition énergétique
Les politiques douanières exercent une influence ambivalente sur la transition énergétique. D'un côté, elles peuvent favoriser le développement local des énergies renouvelables en protégeant les industries naissantes : « Au moment de l'annonce de l'IRA (Inflation Reduction Act), nous craignions beaucoup ce phénomène d'aspiration des investissements européens aux États-Unis, rappelle Elvire Fabry. Depuis 2024, c'est plutôt une incitation à miser sur les orientations réglementaires européennes ».
De l'autre côté, l'escalade tarifaire pourrait freiner les investissements dans la transition énergétique. L'administration Trump a déjà commencé à démanteler les politiques de soutien aux énergies propres mises en place sous la présidence de Joe Biden. Selon Phuc Vinh Nguyen, les conséquences sont déjà mesurables : « Près de 14 milliards d'euros d'investissements dans les technologies propres ont été annulés ou reportés ». Ce recul touche particulièrement les secteurs des véhicules électriques, de l'éolien et des énergies renouvelables. Cela remet en question la trajectoire de décarbonisation américaine, au moment même où les besoins énergétiques explosent avec le développement de l'intelligence artificielle et des centres de données.
En parallèle, la Chine profite de cette fragmentation pour consolider son leadership dans les technologies vertes. « Ce sont des kilomètres et des kilomètres de panneaux solaires qui sont disposés dans certaines régions semi-désertiques », décrit Elvire Fabry. La Chine étend également son influence sur le marché des éoliennes et des pompes à chaleurs. Pendant que les États-Unis font marche arrière, Pékin consolide son avance technologique et sa capacité d'exportation vers les marchés émergents, créant un contraste saisissant entre les deux superpuissances.
L'enjeu n'est plus seulement économique mais éminemment géopolitique. Il faut impérativement préserver la souveraineté énergétique européenne dans un monde où les droits de douane redessinent les cartes de l'énergie et de sa décarbonation. « La course au leadership technologique dans les énergies renouvelables se joue maintenant », avertit Phuc Vinh Nguyen.
L'Europe saura-t-elle saisir cette opportunité ?