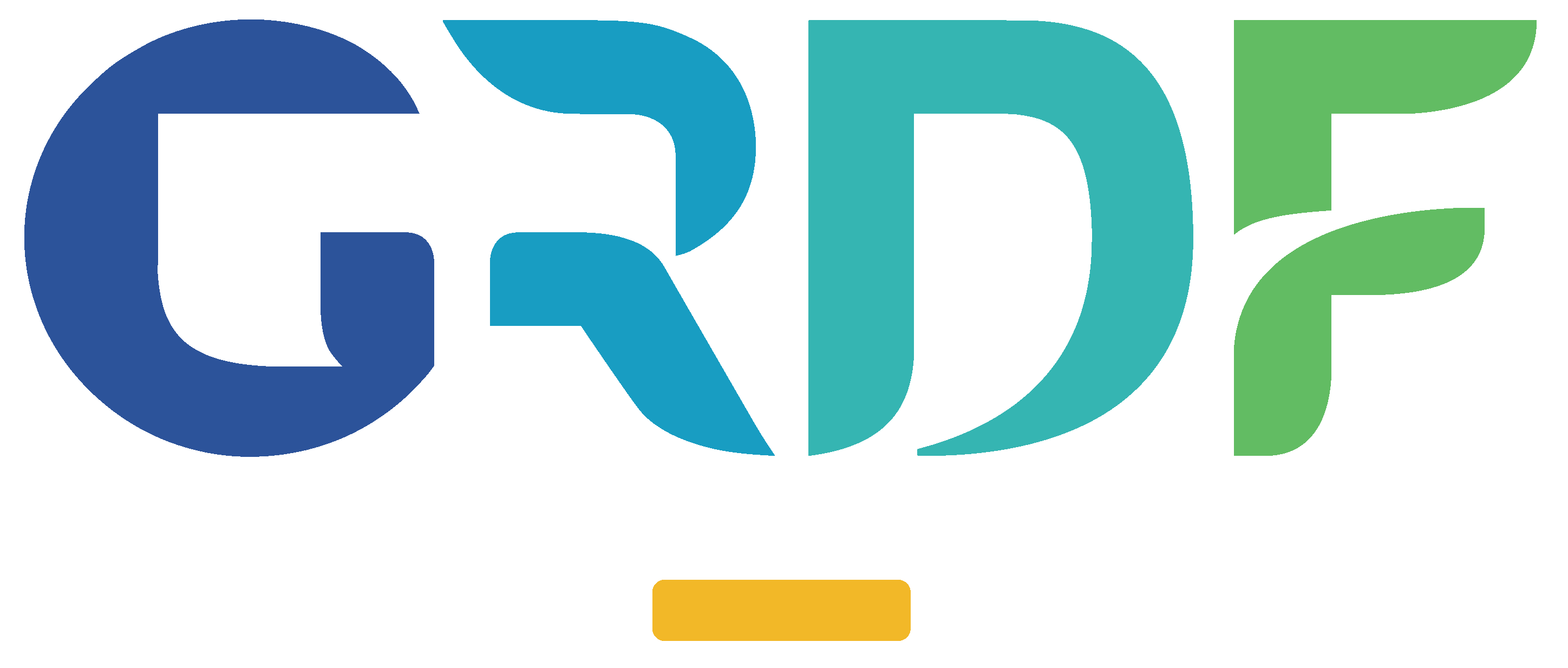Essayiste, haut fonctionnaire et enseignant à Sciences Po, il partage sa vision dans le Grand angle.
Selon les Chambres d’Agriculture France, 47 % des sites de méthanisation sont aujourd’hui détenus par des agriculteurs. Un chiffre qui illustre parfaitement le lien étroit entre le développement de la méthanisation et les territoires ruraux. Mais en quoi consiste réellement la méthanisation et pourquoi cette technologie apporte-t-elle des transformations majeures dans notre société ? Quel est le lien entre ce procédé et le renforcement de la souveraineté énergétique et alimentaire française ? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons tendu le micro à David Djaïz, essayiste, auteur d’un ouvrage sur « La révolution obligée - Réussir la transformation écologique sans dépendre de la Chine et des États-Unis ». Dans ce livre, il présente une transition écologique ambitieuse et démocratique, basée sur des changements profonds dans les modes de vie et l'agriculture. Tout en prônant l'incitation et les investissements plutôt que les sanctions, il tente ainsi de réconcilier écologie et agriculture.
La méthanisation, qu'est-ce que c'est ?
La méthanisation est un processus biologique durant lequel des micro-organismes décomposent la matière organique en l'absence d'oxygène, au sein d’un digesteur. Ce procédé produit à la fois du biogaz, valorisé comme source d’énergie en remplacement notamment du gaz naturel, et du digestat, un résidu organique, utilisé comme engrais fertilisant.
Jeune filière de production d’énergie renouvelable, « la méthanisation s’impose aujourd’hui comme un levier clé de la transition énergétique et écologique en France » indique David Djaïz.
Avec une production de 14 TWh par an, soit l’équivalent de plus de deux réacteurs nucléaires, cette technologie souffre malgré tout de préjugés et idées reçues, comme nombre d’autres énergies, renouvelables ou non. En cause souvent, les appréhensions des riverains au sujet d’éventuelles nuisances liées aux installations. L’essayiste précise pourtant : « une installation bien conçue et bien gérée ne génère ni bruit, ni nuisances olfactives ».
Une nouvelle organisation citoyenne autour d’une énergie durable
Au-delà de la production d’énergie, le développement de la méthanisation apporte de nombreux autres bienfaits à l’échelle locale. On voit notamment émerger de nouveaux modèles de gouvernance dans les territoires ruraux. Initiés par des dynamiques collectives, les projets de méthanisation, majoritairement portés par les agriculteurs, favorisent l’apparition de biens communs locaux. « Les agriculteurs, les citoyens, les entreprises énergétiques ou encore les banques locales travaillent de plus en plus ensemble, dans des jeux collectifs qui tendent vers une démocratie locale », observe David Djaïz. En mutualisant les infrastructures et en intégrant plusieurs acteurs du territoire, la méthanisation renforce la coopération et la structuration d’écosystèmes locaux résilients.
L’essayiste qualifie même la filière de « laboratoire vivant de démocratie énergétique territoriale, où transition écologique, revitalisation rurale et souveraineté énergétique s’articulent en synergie ».
Pour surmonter les réticences et les craintes des riverains, David Djaïz rappelle que : « l’acceptabilité sociale de ces projets de méthanisation repose largement sur la qualité de la gouvernance mise en place, qui associe agriculteurs, habitants, élus, industriels et énergéticiens ». Plus ce cadre de concertation est inclusif et structuré, plus les initiatives sont acceptées par la population. L’accompagnement des parties prenantes et l’organisation d’un dialogue territorial efficace se révèlent ainsi essentiels pour faire de la méthanisation un véritable levier de démocratie locale et de transition énergétique partagée.
La méthanisation et son double impact sur la souveraineté énergétique et la fertilisation des sols
« La crainte de la dépendance aux ressources des puissances étrangères se fait de plus en plus entendre et la montée des hostilités géopolitiques nécessite de trouver rapidement des solutions aux importations d’intrants », explique David Djaïz. Le résidu récupéré lors du processus de méthanisation, le digestat, apparaît comme une solution clé, surtout lorsque 80 % [1] des engrais français proviennent de l’étranger et notamment de la Russie. Cette matière organique est un fertilisant puissant pour les terrains agricoles : grâce à sa forte teneur en minéraux, il agit comme le ferait un pesticide, sans les effets néfastes pour l’environnement et le vivant.
« La méthanisation participe à réduire la dépendance de la France aux ressources étrangères et de renforcer considérablement la souveraineté alimentaire et énergétique telle une boucle vertueuse de l’économie circulaire », explique David Djaïz. La production d’énergie renouvelable et l’agriculture durable s’entraident : les déchets agricoles produisent du biogaz, et le résidu issu de ce processus sert ensuite de fertilisant pour les cultures. La production de gaz français permet ainsi de réduire la dépendance aux énergies fossiles étrangères russes et américaines.
La revitalisation des territoires ruraux, un nouveau souffle dans les campagnes
Autre réalité à l’œuvre :la méthanisation permet de répondre aux défis économiques et financiers rencontrés par les agriculteurs français et les territoires ruraux. « L’agriculteur diversifie ses activités et devient producteur de ressources, les déchets constituant une ressource comme une autre », explique David Djaïz. Face aux mutations du secteur agricole et aux défis économiques, la méthanisation apparaît comme une opportunité majeure. « En plus d’être une source de revenu complémentaire pour les agriculteurs, rappelle l’auteur, la méthanisation participe à la diversification du modèle d’agriculture ».
En effet, près de la moitié des sites de méthanisation sont aujourd’hui portés par des agriculteurs, ce qui en fait un élément vital pour les territoires ruraux et leurs habitants. Alors que la « désagricolisation »[2] fragilise de nombreuses exploitations, cette diversification constitue une réponse aux crises successives qui touchent le secteur, notamment en permettant aux agriculteurs de stabiliser leur activité économique.
« Au-delà des exploitations, la méthanisation joue un rôle structurant dans l’économie locale. En créant des emplois non délocalisables et en dynamisant les filières agricoles, elle participe au renforcement de la résilience des territoires », explique David Djaïz. En réduisant la dépendance aux fluctuations des marchés agricoles et énergétiques, cette filière contribue à stabiliser les revenus des agriculteurs, tout en valorisant les biodéchets issus de la plus grande surface agricole européenne qu’est la France[3].

Crédits : équipe David Djaïz
[1] Évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France, Rapport du Gouvernement, mars 202
[2] C’est le recul de l’activité agricole dans un territoire, marqué par la diminution du nombre d’exploitations, la perte de terres agricoles au profit d’autres usages (urbanisation, artificialisation des sols) et la baisse du poids économique du secteur agricole.
[3] L'agriculture européenne en 10 chiffres clés, Toute l’Europe