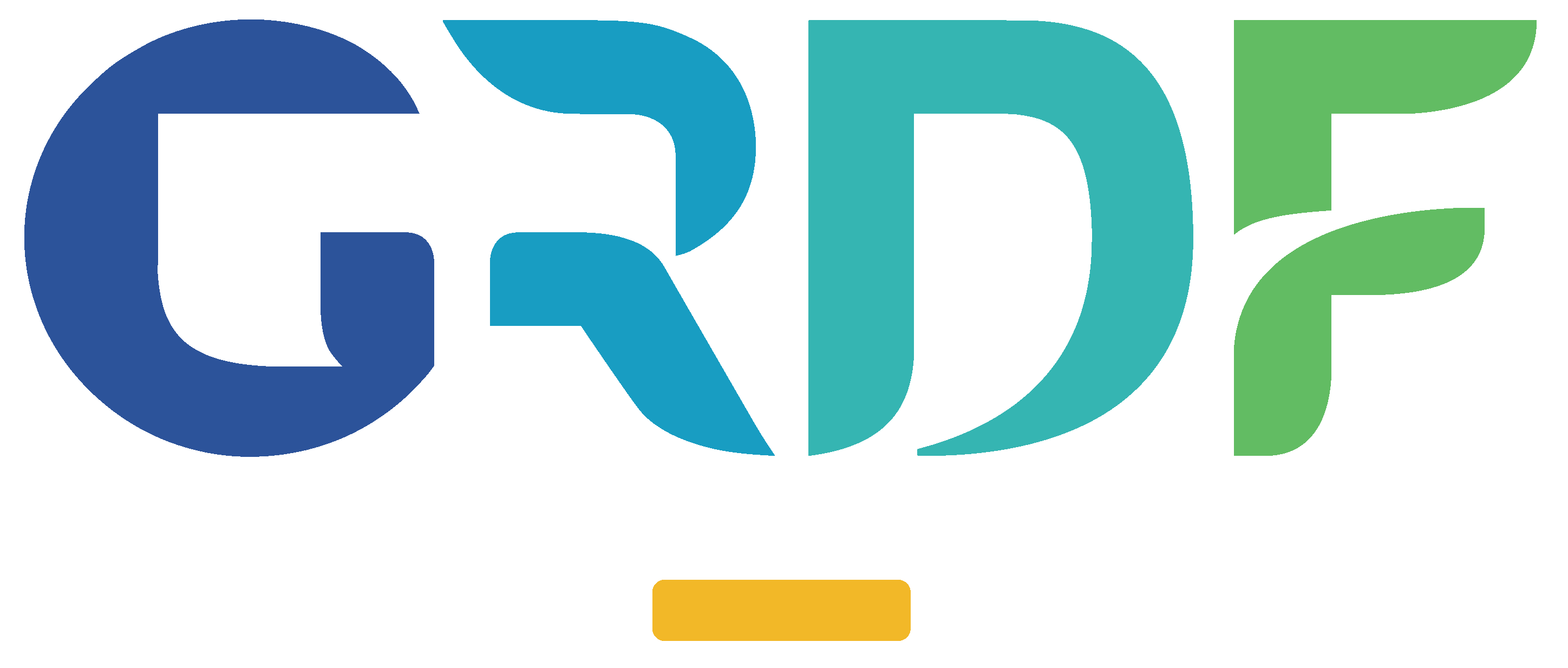Les travaux de la CRE apportent notamment un éclairage sur la place et le rôle du réseau de distribution de gaz en fonction de différents scénarios de consommation / production de gaz verts. Dans un contexte d’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050, les scénarios retenus tablent sur une consommation de gaz française qui varie du simple au double à horizon 2050 : de 165 TWh pour le scénario de l’Ademe qualifié de « très volontariste » à 320 TWh pour celui des gestionnaires de réseaux français.
Réalisé à la demande de la direction générale énergie climat, le rapport de la CRE s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui doit être adoptée cette année. La PPE est un outil de pilotage central de la politique énergétique française.
Françoise Penaud, directrice économie régulation de GRDF, répond à 3 questions afin d’apporter son éclairage sur ce rapport.
Quelles sont, selon vous, les grandes conclusions à retenir de ce rapport ?
F.P. : La CRE a formulé 9 grands enseignements en répondant à 2 critères : assurer la souveraineté énergétique de la France et afficher une consommation de gaz 100 % renouvelable en 2050.
Tout d’abord, il faut retenir que quel que soit le scénario de consommation de gaz en 2050, les infrastructures gazières sont nécessaires à l’équilibre du système énergétique français et à la sécurité d’approvisionnement en énergie de la France et de l’Europe.
Ensuite, les investissements réseaux nécessaires pour accueillir 100 % de gaz verts (hors hydrogène) seront compris entre 6 et 9,7 Mds€ d’ici 2050. L’effort d’investissement annuel, compris entre 200 et 300 M€ par an selon les scénarios, est raisonnable au regard des coûts d’investissements actuels, mais surtout en comparaison des investissements nécessaires à l’adaptation des réseaux d’électricité pour accueillir la production renouvelable, telle qu’estimée notamment dans les « futurs énergétiques » de RTE sur les réseaux électriques.
Concernant le réseau de distribution, il conservera sa place au niveau national tout en étant dimensionné pour accueillir la production de gaz vert. À l’échelle locale, en fonction des configurations, des abandons d’ouvrages seront possibles mais resteront très limités. Trouver le bon équilibre entre les énergies sera nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement et la maitrise des coûts.
Enfin, la CRE réaffirme qu’en cas de conversion massive de clients alimentés en gaz vers d’autres énergies, les conséquences sur les autres réseaux ne sont absolument pas neutres en matière de puissance reportée ou de coûts engendrés pour la collectivité. Cela serait donc une erreur de précipiter des décisions qui iraient dans ce sens au niveau national sans avoir mené au préalable une étude complète des impacts sur l’ensemble du système énergétique. C’est d’ailleurs la limite de ce rapport. Il serait nécessaire que le même travail approfondi soit réalisé sur l’ensemble des infrastructures énergétiques, au premier desquels les infrastructures électriques. En effet, l’ensemble des études prospectives conclut à une forte croissance de la demande électrique, le plus souvent associée à une forte hausse des coûts de production et des investissements liés à l’adaptation et au renforcement réseaux.
Comment GRDF a contribué à ce rapport ?
F.P. : La CRE a su s’appuyer sur l’expertise de GRDF pour mener à bien sa mission. Des points qui nous semblaient importants ont été mis en avant dans la méthodologie retenue par le régulateur pour établir ce rapport.
Les travaux menés par GRDF de fin 2021 à mars 2023, ont été le fruit d’un travail collaboratif entre directions nationales et entités régionales. L’apport des régions sollicitées a été déterminant pour la réalisation des études locales. Au-delà des études de réseaux détaillées et de leurs connaissances fines des portefeuilles clients, les équipes ont contribué à mettre en avant de nouveaux arguments spécifiques à chaque territoire et à réorienter les conclusions sur certaines thématiques. Par exemple, l’interdiction du gaz ou le démantèlement des réseaux pourraient faire apparaitre localement des problématiques annexes à prendre en compte. Ainsi, se priver du gaz dans des zones aujourd’hui desservies au fioul revient à se priver d’un levier pour décarboner.
Pourquoi ce rapport est important pour l’ensemble de la filière gaz mais aussi pour les collectivités ?
F.P. : Les opérateurs gaziers ont mené de nombreuses analyses afin de répondre aux demandes de la CRE. Puis, ces travaux ont été challengés et complétés par de nouvelles analyses réalisées en propre par le régulateur. La CRE s’est attachée à objectiver le rôle des infrastructures gazières à l’horizon 2050 et à mettre en avant la nécessaire articulation entre la vision nationale et les impacts au niveau local. Enfin, le régulateur insiste sur l’importance d’une vision transversale entre les réseaux électriques et les réseaux gaziers car le mix énergétique du futur doit être appréhendé dans une logique de complémentarité.
La CRE est un acteur dont la voix porte dans le paysage énergétique français. Ce rapport est un véritable support pour éclairer les pouvoirs publics lors de l’élaboration des futures politiques énergétiques. En soulignant notamment la place essentielle des réseaux de distribution de gaz - véritable patrimoine industriel des collectivités – pour réussir l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, la CRE repositionne les infrastructures gazières dans le débat sur l’avenir énergétique de la France. C’est donc une première étape essentielle qui nécessitera des travaux complémentaires.